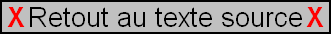
|
Bergson - Evolution Créatrice - Chapitre 4 Esquisse d'une critique des systèmes fondée sur l'analyse des idées de néant et d'immutabilité. L'existence et le néant Il nous reste à examiner en elles-mêmes deux illusions théoriques que nous avons constamment rencontrées sur notre chemin, et dont nous avions envisagé jusqu'à présent les conséquences plutôt que le principe. Tel sera l'objet du présent chapitre. Il nous fournira l'occasion d'écarter certaines objections, de dissiper certains malentendus, et surtout de définir plus nettement, en l'opposant à d'autres, une philosophie qui voit dans la durée l'étoffe même de la réalité. Matière ou esprit, la réalité nous est apparue comme un perpétuel devenir. Elle se fait ou elle se défait, mais elle n'est jamais quelque chose de fait. Telle est l'intuition que nous avons de l'esprit quand nous écartons le voile qui s'interpose entre notre conscience et nous. Voilà aussi ce que l'intelligence et les sens eux-mêmes nous montreraient de la matière, s'ils en obtenaient une représentation immédiate et désintéressée. Mais, préoccupée avant tout des nécessités de l'action, l'intelligence, comme les sens, se borne à prendre de loin en loin, sur le devenir de la matière, des vues instantanées et, par là même, immobiles. La conscience, se réglant à son tour sur l'intelligence, regarde de la vie intérieure ce qui est déjà fait, et ne la sent que confusément se faire. Ainsi se détachent de la durée les moments qui nous intéressent et que nous avons cueillis le long de son parcours. Nous ne retenons qu'eux. Et nous avons raison de le faire, tant que l'action est seule en cause. Mais lorsque, spéculant sur la nature du réel, nous le regardons encore comme notre intérêt pratique nous demandait de le regarder, nous devenons incapables de voir l'évolution vraie, le devenir radical. Nous n'apercevons du devenir que des états, de la durée que des instants, et, même quand nous parlons de durée et de devenir, c'est à autre chose que nous pensons. Telle est la plus frappante des deux illusions que nous voulons examiner. Elle consiste a croire qu'on pourra penser l'instable par l'intermédiaire du stable, le mouvant par l'immobile. L'autre illusion est proche parente de la première. Elle a la même origine. Elle vient, elle aussi, de ce que nous transportons à la spéculation un procédé fait pour la pratique. Toute action vise à obtenir un objet dont on se sent prive, ou a créer quelque chose qui n'existe pas encore. En ce sens très particulier, elle comble un vide et va du vide au plein, d'une absence à une présence, de l'irréel au réel. L'irréalité dont il s'agit ici est d'ailleurs purement relative à la direction où s'est engagée notre attention, car nous sommes immergés dans des réalités et n'en pouvons sortir ; seulement, si la réalité présente n'est pas celle que nous cherchions, nous parlons de l'absence de la seconde là où nous constatons la présence de la première. Nous exprimons ainsi ce que nous avons en fonction de ce que nous voudrions obtenir. Rien de plus légitime clans le domaine de l'action. Mais, bon gré malgré, nous conservons cette manière de parler, et aussi de penser, quand nous spéculons sur la nature des choses indépendamment de l'intérêt qu'elles ont pour nous. Ainsi naît la seconde des deux illusions que nous signalions, celle que nous allons approfondir d'abord. Elle tient, comme la première, aux habitudes statiques que notre intelligence contracte quand elle prépare notre action sur les choses. De même que nous passons par l'immobile pour aller au mouvant, ainsi nous nous servons du vide pour penser le plein. Déjà nous avons trouvé cette illusion sur notre chemin quand nous avons abordé le problème fondamental de la connaissance. La question, disions-nous, est de savoir pourquoi il y a de l'ordre, et non pas du désordre, dans les choses. Mais la question n'a de sens que si l'on suppose que la désordre, entendu comme une absence d'ordre, est possible, ou imaginable, ou concevable. Or, il n'y a de réel que l'ordre; mais, comme l'ordre peut prendre deux formes, et que la présence de l'une consiste, si l'on veut, dans l'absence de l'autre, nous parlons de désordre toutes les fois que nous sommes devant celui des deux ordres que nous ne cherchions pas. L'idée de désordre est donc toute pratique. Elle correspond à une certaine déception d'une certaine attente, et ne désigne pas l'absence de tout ordre, mais seulement la présence d'un ordre qui n'offre pas d'intérêt actuel. Que si l'on essaie de nier l'ordre complètement, absolument, on s'aperçoit qu'on saute indéfiniment d'une espèce d'ordre à l'autre, et que la prétendue suppression de l'une et de l'autre implique la présence des deux. Enfin si l'on passe outre, si, de parti pris, on ferme les yeux sur ce mouvement de l'esprit et sur tout ce qu'il suppose, on n'a plus affaire à une idée, et du désordre il ne reste qu'un mot. Ainsi le problème de la connaissance est compliqué, et peut-être rendu insoluble, par l'idée que l'ordre comble un vide, et que sa présence effective est superposée à son absence virtuelle. Nous allons de l'absence à la présence, du vide au plein, en vertu de l'illusion fondamentale de notre entendement. Voilà l'erreur dont nous signalons une conséquence dans notre dernier chapitre. Comme nous le faisions pressentir, nous n'aurons définitivement raison de cette erreur que si nous la prenons corps à corps. Il faut que nous la regardions bien en face, en elle-même, dans la conception radicalement fausse qu'elle implique de la négation, du vide, et du néant . Les philosophes ne se sont guère occupés de l'idée de néant. Et pourtant elle est souvent le ressort caché, l'in. visible moteur de la pensée philosophique. Dès le premier éveil de la réflexion, c'est elle qui pousse en avant, droit sous le regard de la conscience, les problèmes angoissants, les questions qu'on ne peut fixer sans être pris de vertige. Je n'ai pas plutôt commencé à philosopher que je me demande pourquoi j'existe ; et quand je me suis rendu compte de la solidarité qui me lie au reste de l'univers, la difficulté n'est que reculée, je veux savoir pourquoi l'univers existe ; et si je rattache l'univers à un Principe immanent ou transcendant qui le supporte ou qui le crée, ma pensée ne se repose dans ce principe que pour quelques instants ; le même problème se pose, cette fois dans toute son ampleur et sa généralité : d'où vient, comment comprendre que quelque chose existe ? Ici même, dans le présent travail, quand la matière a été définie par une espèce de descente, cette descente par l'interruption d'une montée, cette montée elle-même par une croissance, quand un Principe de création enfin a été mis au fond des choses, la même question surgit : comment, pourquoi ce principe existe-t-il, plutôt que rien ? Maintenant, si j'écarte ces questions pour aller à ce qui se dissimule derrière elles, voici ce que je trouve. L'existence m'apparaît comme une conquête sur le néant. Je me dis qu'il pourrait, qu'il devrait même ne rien y avoir, et je m'étonne alors qu'il y ait quelque chose. Ou bien je me représente toute réalité comme étendue sur le néant, ainsi que sur un tapis : le néant était d'abord, et l'être est venu par surcroît. Ou bien encore, si quelque chose a toujours existé, il faut que le néant lui ait toujours servi de substrat ou de réceptacle, et lui soit, par conséquent, éternellement antérieur. Un verre a beau être toujours plein, le liquide qui le remplit n'en comble pas moins un vide. De même, l'être a pu se trouver toujours là : le néant, qui est rempli et comme bouché par lui, ne lui en préexiste pas moins, sinon en fait, du moins en droit. Enfin je ne puis me défaire de l'idée que le plein est une broderie sur le canevas du vide, que l'être est superposé au néant, et que dans la représentation de « rien » il y a moins que dans celle de« quelque chose» . De là tout le mystère. Il faut que ce mystère soit éclairci. Il le faut surtout, si l'on met au fond des choses la durée et le libre choix. Car le dédain de la métaphysique pour toute réalité qui dure vient précisément de ce qu'elle n'arrive à l'être qu'en passant par le « néant », et de ce qu'une existence qui dure ne lui paraît pas assez forte pour vaincre l'inexistence et se poser elle-même. C'est pour cette raison surtout qu'elle incline à doter l'être véritable d'une existence logique, et non pas psychologique ou physique. Car telle est la nature d'une existence purement logique qu'elle semble se suffire à elle-même, et se poser par le seul effet de la force immanente à la vérité. Si je me demande pourquoi des corps ou des esprits existent plutôt que rien, je ne trouve pas de réponse. Mais qu'un principe logique tel que A = A ait la vertu de se créer lui-même, triomphant du néant dans l'éternité, cela me semble naturel. L'apparition d'un cercle tracé à la craie sur un tableau est chose qui a besoin d'être expliquée : cette existence toute physique n'a pas, par elle-même, de quoi vaincre l'inexistence. Mais l' « essence logique » du cercle, c'est-à-dire la possibilité de le tracer selon une certaine loi, c'est-à-dire enfin sa définition, est chose qui me paraît éternelle ; elle n'a ni lieu ni date, car nulle part, à aucun moment, le tracé d'un cercle n'a commencé d'être possible. Supposons donc au principe sur lequel toutes choses reposent et que toutes choses manifestent une existence de même nature que celle de la définition du cercle, ou que celle de l'axiome A = A : le mystère de l'existence s'évanouit, car l'être qui est au fond de tout se pose alors dans l'éternel comme se pose la logique même. Il est vrai qu'il nous en coûtera un assez gros sacrifice : si le principe de toutes choses existe à la manière d'un axiome logique ou d'une définition mathématique, les choses elles-mêmes devront sortir de ce principe comme les applications d'un axiome ou les conséquences d'une définition, et il n'y aura plus de place, ni dans les choses ni dans leur principe, pour la causalité efficace entendue au sens d'un libre choix. Telles sont précisément les conclusions d'une doctrine comme celle de Spinoza ou même de Leibniz par exemple, et telle en a été la genèse. Si nous pouvions établir que l'idée de néant, au sens où nous la prenons quand nous l'opposons à celle d'existence, est une pseudo-idée, les problèmes qu'elle soulève autour d'elle deviendraient des pseudo-problèmes. L'hypothèse d'un absolu qui agirait librement, qui durerait éminemment, n'aurait plus rien de choquant. Le chemin serait frayé à une philosophie plus rapprochée de l'intuition, et qui ne demanderait plus les mêmes sacrifices au sens commun. Voyons donc a quoi l'on pense quand on parle du néant. Se représenter le néant consiste ou à l'imaginer ou à le concevoir. Examinons ce que peut être cette image ou cette idée. Commençons par l'image. Je vais fermer les yeux, boucher mes oreilles, éteindre une à une les sensations qui m'arrivent du monde extérieur : voilà qui est fait, toutes mes perceptions s'évanouissent, l'univers matériel s'abîme pour moi dans le silence et dans la nuit. Je subsiste cependant, et ne puis m'empêcher de subsister. Je suis encore là, avec les sensations organiques qui m'arrivent de la périphérie et de l'intérieur de mon corps, avec les souvenirs que me laissent mes perceptions passées, avec l'impression même, bien positive et bien pleine, du vide que je viens de faire autour de moi. Comment supprimer tout cela ? comment s'éliminer soi-même ? Je puis, à la rigueur, écarter mes souvenirs et oublier jusqu'à mon passé immédiat ; je conserve du moins la conscience que j'ai de mon présent réduit à sa plus extrême pauvreté, c'est-à-dire de l'état actuel de mon corps. Je vais essayer cependant d'en finir avec cette conscience elle-même. J'atténuerai de plus en plus les sensations que mon corps m'envoie : les voici tout près de s'éteindre ; elles s'éteignent, elles disparaissent dans la nuit où se sont déjà perdues toutes choses. Mais non ! à l'instant même où ma conscience s'éteint, une autre conscience s'allume ; - ou plutôt elle s'était allumée déjà, elle avait surgi l'instant d'auparavant pour assister à la disparition de la première. Car la première ne pouvait disparaître que pour une autre et vis-à-vis d'une autre. Je ne me vois anéanti que si, par un acte positif, encore qu'involontaire et inconscient, je me suis déjà ressuscité moi-même. Ainsi j'ai beau faire, je perçois toujours quelque chose, soit du dehors, soit du dedans. Quand je ne connais plus rien des objets extérieurs, c'est que je me réfugie dans la conscience que j'ai de moi-même ; si j'abolis cet intérieur, son abolition même devient un objet pour un moi imaginaire qui, cette fois, perçoit comme un objet extérieur le moi qui disparaît. Extérieur ou intérieur, il y a donc toujours un objet que mon imagination se représente. Elle peut, il est vrai, aller de l'un à l'autre, et, tour à tour, imaginer un néant de perception externe ou un néant de perception intérieure, -mais non pas les deux à la fois, car l'absence de l'un consiste, au fond, dans la présence exclusive de l'autre. Mais, de ce que deux néants relatifs sont imaginables tour à tour, on conclut à tort qu'ils sont imaginables ensemble : conclusion dont l'absurdité devrait sauter aux yeux, puisqu'on ne saurait imaginer un néant sans s'apercevoir, au moins confusément, qu'on l'imagine, c'est-à-dire qu'on agit, qu'on pense, et que quelque chose, par conséquent, subsiste encore. L'image proprement dite d'une suppression de tout n'est donc jamais formée par la pensée. L'effort par lequel nous tendons à créer cette image aboutit simplement à nous faire osciller entre la vision d'une réalité extérieure et celle d'une réalité interne. Dans ce va-et-vient de notre esprit entre le dehors et le dedans, il y a un point, situé à égale distance des deux, où il nous semble que nous n'apercevons plus l'un et que nous n'apercevons pas encore l'autre : c'est là que se forme l'image du néant. En réalité, nous apercevons alors l'un et l'autre, étant arrivés au point où les deux termes sont mitoyens, et l'image du néant, ainsi définie, est une image pleine de choses, une image qui renferme à la fois celle du sujet et celle de l'objet, avec. en plus, un saut perpétuel de l'une à l'autre et la refus de jamais se poser définitivement sur l'une d'elles, Il est évident que ce n'est pas ce néant-là que nous pour. rions opposer à l'être, et mettre avant lui ou au-dessous de lui, puisqu'il renferme déjà l'existence en général. Mais on nous dira que, si la représentation du néant intervient, visible ou latente, dans les raisonnements des philosophes, ce n'est pas sous forme d'image, mais d'idée. On nous accordera que nous n'imaginons pas une aboliion de tout, mais on prétendra que nous pouvons la concevoir. On entend, disait Descartes, un polygone de mille côtés,quoiqu'on ne le voie pas en imagination : il suffit qu'on se représente clairement la possibilité de le construire. De même pour l'idée d'une abolition de toutes choses. Rien de plus simple, dira-t-on, que le procédé par lequel on en construit l'idée. Il n'est pas un seul objet de notre expérience, en effet, que nous ne puissions supposer aboli. Étendons cette abolition d'un premier objet à un second, puis à un troisième, et ainsi de suite aussi longtemps qu'on voudra : le néant n'est pas autre chose que la limite où tend l'opération. Et le néant ainsi défini est bien l'abolition du tout. - Voilà la thèse, il suffit de la considérer sous cette forme pour apercevoir l'absurdité qu'elle recèle. Une idée construite de toutes pièces par l'esprit n'est une idée, en effet, que si les pièces sont capables de coexister ensemble : elle se réduirait à un simple mot, si les éléments qu'on rapproche pour la composer se chassaient les uns les autres au fur et à mesure qu'on les assemble. Quand j'ai défini le cercle, je me représente sans peine un cercle noir ou un cercle blanc, un cercle en carton, en fer ou en cuivre, un cercle transparent ou un cercle opaque, - mais non pas un cercle carré, parce que la loi de génération du cercle exclut la possibilité de limiter cette figure avec des lignes droites. Ainsi mon esprit peut se représenter abolie n'importe quelle chose existante, mais si l'abolition de n'importe quoi par l'esprit était une opération dont le mécanisme impliquât qu'elle s'effectue sur une partie du Tout et non pas sur le Tout lui-même, alors l'extension d'une telle opération à la totalité des choses pourrait devenir chose absurde, contradictoire avec elle-même, et l'idée d'une abolition de tout présenterait Peut-être les mêmes caractères que celle d'un cercle carré : ce ne serait plus une idée, ce ne serait qu'un mot. Examinons donc de près le mécanisme de l'opération. En fait, l'objet qu'on supprime est ou extérieur ou intérieur : c'est une chose ou c'est un état de conscience. Considérons le premier cas. J'abolis par la pensée un objet extérieur : à l'endroit où il était, « il n'y a plus rien ». - Plus rien de cet objet, sans aucun doute, mais un autre objet a pris sa place : il n'y a pas de vide absolu dans la nature. Admettons pourtant que le vide absolu soit possible ; ce n'est pas à ce vide que je pense quand je dis que l'objet, une fois aboli, laisse sa place inoccupée, car il s'agit par hypothèse d'une place, c'est-à-dire d'un vide limité par des contours précis, c'est-à-dire d'une espèce de chose. Le vide dont je parle n'est donc, au fond, que l'absence de tel objet déterminé, lequel était ici d'abord, se trouve mainte. nant ailleurs et, en tant qu'il n'est plus à son ancien lieu, laisse derrière lui, pour ainsi dire, le vide de lui-même. Un être qui ne serait pas doué de mémoire ou de prévision ne prononcerait jamais ici les mots de « vide » ou de « néant » ; il exprimerait simplement ce qui est et ce qu'il perçoit; or, ce qui est et ce qu'on perçoit, c'est la présence d'une chose ou d'une autre, jamais l'absence de quoi que ce soit. Il n'y a d'absence que pour un être capable de souvenir et d'attente. Il se souvenait d'un objet et s'attendait peut-être à le rencontrer : il en trouve un autre, et il exprime la déception de son attente, née elle-même du souvenir, en disant qu'il ne trouve plus rien, qu'il se heurte au néant. Même s'il ne s'attendait pas à rencontrer l'objet, c'est une attente possible de cet objet, c'est encore la déception de son attente éventuelle, qu'il traduit en disant que l'objet n'est plus où il était. Ce qu'il perçoit, en réalité, ce qu'il réussit à penser effectivement, c'est la présence de l'ancien objet à une nouvelle place ou celle d'un nouvel objet à l'ancienne; le reste, tout ce qui s'exprime négativement par des mots tels que le néant ou le vide, n'est pas tant pensée qu'affection, ou, pour parler plus exactement, coloration affective de la pensée. L'idée d'abolition ou de néant partiel se forme donc ici au cours de la substitution d'une chose à une autre, dès que cette substitution est pensée par un esprit qui préférerait maintenir l'ancienne chose à la place de la nouvelle ou qui conçoit tout au moins cette préférence comme possible. Elle implique du côté subjectif une préférence, du côté objectif une substitution, et n'est point autre chose qu'une combinaison, ou plutôt une interférence, entre ce sentiment de préférence et cette idée de substitution. Tel est le mécanisme de l'opération par laquelle notre esprit abolit un objet et arrive à se représenter, dans le monde extérieur, un néant partiel. Voyons maintenant comment il se le représente à l'intérieur de lui-même. Ce que nous constatons en nous, ce sont encore des phénomènes qui se produisent, et non pas, évidemment, des phénomènes qui ne se produisent pas. J'éprouve une sensation ou une émotion, je conçois une idée, je prends une résolution : ma conscience perçoit ces faits qui sont autant de présences, et il n'y a pas de moment où des faits de ce genre ne me soient présents. Je puis sans doute interrompre, par la pensée, le cours de ma vie intérieure, supposer que je dors sans rêve ou que j'ai cessé d'exister ; mais, à l'instant même où je fais cette supposition, je me conçois, je m'imagine veillant sur mon sommeil ou survivant à mon anéantissement, et je ne renonce à me percevoir du dedans que pour me réfugier dans la perception extérieure de moi-même. C'est dire qu'ici encore le plein succède toujours au plein, et qu'une intelligence qui ne serait qu'intelligence, qui n'aurait ni regret ni désir, qui réglerait son mouvement sur le mouvement de son objet, ne concevrait même pas une absence ou un vide. La conception d'un vide naît ici quand la conscience, retardant sur elle-même, reste attachée au souvenir d'un état ancien alors qu'un autre état est déjà présent. Elle n'est qu'une comparaison entre ce qui est et ce qui pourrait ou devrait être, entre du plein et du plein. En un mot, qu'il s'agisse d'un vide de matière ou d'un vide de conscience, la représentation du vide est toujours une représentation pleine, qui se résout à l'analyse en deux éléments positifs ; l'idée, distincte ou confuse, d'une substitution, et le sentiment, éprouvé ou imaginé, d'un désir ou d'un regret. Il suit de cette double analyse que l'idée du néant absolu, entendu au sens d'une abolition de tout, est une idée destructive d'elle-même, une pseudo-idée, un simple mot. Si supprimer une chose consiste à la remplacer par une autre, si penser l'absence d'une chose n'est possible que par la représentation plus ou moins explicite de la présence de quelque autre chose, enfin si abolition signifie d'abord substitution, l'idée d'une « abolition de tout » est aussi absurde que celle d'un cercle carré. L'absurdité ne saute pas aux yeux, par ce qu'il n'existe pas d'objet particulier qu'on ne puisse supposer aboli : alors, de ce qu'il n'est pas interdit de supprimer par la pensée chaque chose tour à tour, on conclut qu'il est possible de les supposer supprimées toutes ensemble. On ne voit pas que supprimer chaque chose tour à tour, consiste précisément à la remplacer au fur et à mesure par une autre, et que dès lors la suppression de tout absolument implique une véritable contradiction dans les termes, puisque cette opération consisterait à détruire la condition même qui lui permet de s'effectuer. Mais l'illusion est tenace. De ce que supprimer une chose consiste en fait à lui en substituer une autre, on ne conclura pas, on ne voudra pas conclure que l'abolition d'une chose par la pensée implique la substitution, par la pensée, d'une nouvelle chose à l'ancienne. On nous accordera qu'une chose est toujours remplacée par une autre chose, et même que notre esprit ne peut penser la disparition d'un objet extérieur ou intérieur sans se représenter, - sous une forme indéterminée et confuse, il est vrai, - qu'un autre objet s'y substitue. Mais on ajoutera que la représentation d'une disparition est celle d'un phénomène qui se produit dans l'espace ou tout au moins dans le temps, qu'elle implique encore, par conséquent, l'évocation d'une image, et qu'il s'agirait précisément ici de s'affranchir de l'imagination pour faire appel à l'entendement pur. Ne parlons donc plus, nous dira-t-on, de disparition ou d'abolition ; ce sont là des opérations physiques. Ne nous représentons plus que l'objet A soit aboli ou absent. Disons simplement que nous le pensons « inexistant ». L'abolir est agir sur lui dans le temps et peut-être aussi dans l'espace ; c'est accepter, par conséquent, les conditions de l'existence spatiale et temporelle, accepter la solidarité qui lie un objet à tous les autres et l'empêche de disparaître sans être remplacé aussitôt. Mais nous pouvons nous affranchir de ces conditions : il suffit que, par un effort d'abstraction, nous évoquions la représentation de l'objet A tout seul, que nous convenions d'abord de le considérer comme existant, et qu'ensuite, par un trait de plume intellectuel, nous biffions cette clause. L'objet sera alors, de par notre décret, inexistant. Soit. Biffons purement et simplement la clause. Il ne faut pas croire que notre trait de plume se suffise à lui-même et qu'il soit, lui, isolable du reste des choses. On va voir qu'il ramène avec lui, bon gré, mal gré, tout ce dont nous prétendions nous abstraire. Comparons, en effet, entre elles les deux idées de l'objet A supposé réel et du même objet supposé« inexistant». L'idée de l'objet A supposé existant n'est que la représentation pure et simple de l'objet A, car on ne peut pas se représenter un objet sans lui attribuer, par là même, une certaine réalité. Entre penser un objet et le penser existant, il n'y a absolument aucune différence : Kant a mis ce point en pleine lumière dans sa critique de l'argument ontologique. Dès lors, qu'est-ce que penser l'objet A inexistant ? Se le représenter inexistant ne peut pas consister à retirer de l'idée de l'objet A l'idée de l'attribut« existence », puisque, encore une fois, la représentation de l'existence de l'objet est inséparable de la représentation de l'objet et ne fait même qu'un avec elle. Se représenter l'objet A inexistant ne peut donc consister qu'à ajouter quelque chose à l'idée de cet objet : on y ajoute, en effet, l'idée d'une exclusion de cet objet particulier par la réalité actuelle en général. Penser l'objet A inexistant, c'est penser l'objet d'abord, et par conséquent le penser existant ; c'est ensuite penser qu'une autre réalité, avec laquelle il est incompatible, le supplante. Seulement, il est inutile que nous nous représentions explicitement cette dernière réalité ; nous n'avons pas à nous occuper de ce qu'elle est; il nous suffit de savoir qu'elle chasse l'objet A, lequel est seul à nous intéresser. C'est pourquoi nous pensons à l'expulsion plutôt qu'à la cause qui expulse. Mais cette cause n'en est pas moins présente à l'esprit ; elle y est à l'état implicite, ce qui expulse étant inséparable de l'expulsion comme la main qui pousse la plume est inséparable du trait de plume qui biffe. L'acte par lequel on déclare un objet irréel pose donc l'existence du réel en général. En d'autres termes, se représenter un objet comme irréel ne peut pas consister à le priver de toute espèce d'existence, puisque la représentation d'un objet est nécessairement celle de cet objet existant. Un pareil acte consiste simplement à déclarer que l'existence attachée par notre esprit à l'objet, et inséparable de sa représentation, est une existence tout idéale, celle d'un simple possible. Mais idéalité d'un objet, simple possibilité d'un objet, n'ont de sens que par rapport à une réalité qui chasse dans la région de l'idéal ou du simple possible cet objet incompatible avec elle. Supposez abolie l'existence plus forte et plus substantielle, c'est l'existence atténuée et plus faible du simple possible qui va devenir la réalité même, et vous ne vous représenterez plus alors l'objet comme inexistant. En d'autres termes, et si étrange que notre assertion puisse paraître, il y a plus, et non pas moins, dans l'idée d'un objet conçu comme « n'existant pas » que dans l'idée de ce même objet conçu comme « existant », car l'idée de l'objet « n'existant pas » est nécessairement l'idée de l'objet « existant », avec, en plus, la représentation d'une exclusion de cet objet par la réalité actuelle prise en bloc. Mais on prétendra que notre représentation de l'inexistant n'est pas encore assez dégagée de tout élément imaginatif, pas assez négative. « Peu importe, nous dira-t-on, que l'irréalité d'une chose consiste dans son expulsion par d'autres. Nous n'en voulons rien savoir. Ne sommes-nous pas libres de diriger notre attention où il nous plaît et comme il nous plaît ? Eh bien, après avoir évoqué la représentation d'un objet et l'avoir supposé par là même, si vous voulez, existant, nous accolerons simplement à notre affirmation un « non », et cela suffira pour que nous le pensions inexistant. C'est là une opération tout intellectuelle, indépendante de ce qui se passe en dehors de l'esprit. Pensons donc n'importe quoi ou pensons tout, puis mettons en marge de notre pensée le « non » qui prescrit le rejet de ce qu'elle contient : nous abolissons idéalement toutes choses par le seul fait d'en décréter l'abolition.» - Au fond, c'est bien de ce prétendu pouvoir inhérent à la négation que viennent ici toutes les difficultés et toutes les erreurs. On se représente la négation comme exactement symétrique de l'affirmation. On s'imagine que la négation, comme l'affirmation, se suffit à elle-même. Dès lors la négation aurait, comme l'affirmation, la puissance de créer des idées, avec cette seule différence que ce seraient des idées négatives. En affirmant une chose, puis une autre chose, et ainsi de suite indéfiniment, je forme l'idée de Tout : de même, en niant une chose, puis les autre choses, enfin en niant Tout, on arriverait à l'idée de Rien. Mais c'est justement cette assimilation qui nous paraît arbitraire. On ne voit pas que, si l'affirmation est un acte complet de l'esprit, qui peut aboutir à constituer une idée, la négation n'est jamais que la moitié d'un acte intellectuel dont on sous-entend ou plutôt dont on remet à un avenir indéterminé l'autre moitié. On ne voit pas non plus que, si l'affirmation est un acte de l'intelligence pure, il entre dans la négation un élément extra-intellectuel, et que c'est précisément à l'intrusion d'un élément étranger que la négation doit son caractère spécifique. Pour commencer par le second point, remarquons que nier consiste toujours à écarter une affirmation possible . La négation n'est qu'une attitude prise par l'esprit vis-à-vis d'une affirmation éventuelle. Quand je dis : « cette table est noire », c'est bien de la table que je parle : je l'ai vue noire, et mon jugement traduit ce que j'ai vu. Mais si je dis : « cette table n'est pas blanche », je n'exprime sûre. ment pas quelque chose que j'aie perçu, car j'ai vu du noir, et non pas une absence de blanc. Ce n'est donc pas, au fond, sur la table elle-même que je porte ce jugement, mais plutôt sur le jugement qui la déclarerait blanche. Je juge un jugement, et non pas la table. La proposition « cette table n'est pas blanche » implique que vous pourriez la croire blanche, que vous la croyiez telle ou que j'allais la croire telle : je vous préviens, ou je m'avertis moi-même, que ce jugement est à remplacer par un autre (que je laisse, il est vrai, indéterminé). Ainsi, tandis que l'affirmation porte directement sur la chose, la négation ne vise la chose qu'indirectement, à travers une affirmation interposée. Une proposition affirmative traduit un jugement porté sur un objet; une proposition négative traduit un jugement porté sur un jugement. La négation diffère donc de l'affirmation proprement dite en ce qu'elle est une affirmation du second degré : elle affirme quelque chose d'une affirmation qui, elle, affirme quelque chose d'un objet.
Mais il suit tout d'abord de là que la négation n'est pas le fait d'un pur esprit, je veux dire d'un esprit détaché de tout mobile, placé en face des objets et ne voulant avoir affaire qu'à eux. Dès qu'on nie, on fait la leçon aux autres ou on se la fait à soi-même. On prend à partie un interlocuteur, réel ou possible, qui se trompe et qu'on met sur ses gardes. Il affirmait quelque chose : on le prévient qu'il devra affirmer autre chose (sans spécifier toutefois l'affirmation qu'il faudrait substituer à la première). Il n'y a plus simplement alors une personne et un objet en présence l'un de l'autre ; il y a, en face de l'objet, une personne parlant à une personne, la combattant et l'aidant tout à la fois ; il y a un commencement de société. La négation vise quelqu'un, et non pas seulement, comme la pure opération intellectuelle, quelque chose. Elle est d'essence pédagogique et sociale. Elle redresse ou plutôt avertit, la personne avertie et redressée pouvant d'ailleurs être, par une espèce de dédoublement, celle même qui parle. Voilà pour le second point. Arrivons au premier. Nous disions que la négation n'est jamais que la moitié d'un acte intellectuel dont on laisse l'autre moitié indéterminée. Si j'énonce la proposition négative « cette table n'est pas blanche », j'entends par là que vous devez substituer à votre jugement « la table est blanche » un autre jugement. je vous donne un avertissement, et l'avertissement porte sur la nécessité d'une substitution. Quant à ce que vous devez substituer à votre affirmation, je ne vous en dis rien, il est vrai. Ce peut être parce que j'ignore la couleur de la table, mais c'est aussi bien, c'est même plutôt bien parce que la couleur blanche est la seule qui nous intéresse pour le moment, et que dès lors j'ai simplement à vous annoncer qu'une autre couleur devra être substituée au blanc, sans avoir à vous dire laquelle. Un jugement négatif est donc bien un jugement indiquant qu'il y a lieu de substituer à un jugement affirmatif un autre jugement affirmatif, la nature de ce second jugement n'étant d'ailleurs pas spécifiée, quelquefois parce qu'on l'ignore, plus souvent parce qu'elle n'offre pas d'intérêt actuel, l'attention ne se portant que sur la matière du premier. Ainsi, toutes les fois que j'accole un « non » à une affirmation, toutes les fois que je nie, j'accomplis deux actes bien déterminés : 1º je m'intéresse à ce qu'affirme un de mes semblables, ou à ce qu'il allait dire, ou à ce qu'aurait pu dire un autre moi que je préviens ; 2º j'annonce qu'une seconde affirmation, dont je ne spécifie pas le contenu, devra être substituée à celle que je trouve devant moi. Mais ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux actes on ne trouvera autre chose que de l'affirmation. Le caractère sui generis de la négation vient de la superposition du premier au second. C'est donc en vain qu'on attribuerait à 1a négation le pouvoir de créer des idées sui generis, symétriques de celles que crée l'affirmation et dirigées en sens contraire. Aucune idée ne sortira d'elle, car elle n'a pas d'autre contenu que celui du jugement affirmatif qu'elle juge. Plus précisément, considérons un jugement existentiel et non plus un jugement attributif. Si je dis : « l'objet A n'existe pas », j'entends par là, d'abord, qu'on pourrait croire que l'objet A existe : comment d'ailleurs penser l'objet A sans le penser existant, et quelle différence peut-il y avoir, encore une fois, entre l'idée de l'objet A existant et l'idée pure et simple de l'objet A ? Donc, par cela seul que je dis « l'objet A », je lui attribue une espèce d'existence, fût-ce celle d'un simple possible, c'est-à-dire d'une pure idée. Et par conséquent dans le jugement l'objet A n'est pas » il y a d'abord une affirmation telle que : « l'objet A a été », ou : « l'objet A sera », ou plus généralement : « l'objet A existe au moins comme simple possible ». Maintenant, quand j'ajoute les deux mots « n'est pas », que puis-je entendre par là sinon que, si l'on va plus loin, si l'on érige l'objet possible en objet réel, on se trompe, et que le possible dont je parle est exclu de la réalité actuelle comme incompatible avec elle ? Les jugements qui posent la non-existence d'une chose sont donc des jugements qui formulent un contraste entre le possible et l'actuel (c'est-à-dire entre deux espèces d'existence, l'une pensée et l'autre constatée) dans des cas où une personne, réelle ou imaginaire, croyait à tort qu'un certain possible était réalisé. A la place de ce possible il y a une réalité qui en diffère et qui le chasse : le jugement négatif exprime ce contraste, mais il l'exprime sous une forme volontairement incomplète, parce qu'il s'adresse à une personne qui, par hypothèse, s'intéresse exclusivement au possible indiqué et ne s'inquiétera pas de savoir par quel genre de réalité le possible est remplacé. L'expression de la substitution est donc obligée de se tronquer. Au lieu d'affirmer qu'un second terme s'est substitué au premier, on maintiendra sur le premier, et sur le premier seul, l'attention qui se dirigeait sur lui d'abord. Et, sans sortir du premier, on affirmera implicitement qu'un second terme le remplace en disant que le premier « n'est pas ». On jugera ainsi un jugement au lieu de juger une chose. On avertira les autres ou l'on s'avertira soi-même d'une erreur possible, au lieu d'apporter une information positive. Supprimez toute intention de ce genre, rendez à la connaissance son caractère exclusivement scientifique ou philosophique, supposez, en d'autres termes, que la réalité vienne s'inscrire d'elle-même sur un esprit qui ne se soucie que des choses et ne s'intéresse pas aux personnes : on affirmera que telle ou telle chose est, on n'affirmera jamais qu'une chose n'est pas. D'où vient donc qu'on s'obstine à mettre l'affirmation et la négation sur la même ligne et à les doter d'une égale objectivité ? D'où vient qu'on a tant de peine à reconnaître ce que la négation a de subjectif, d'artificiellement tronqué, de relatif à l'esprit humain et surtout à la vie sociale ? La raison en est sans doute que négation et affirmation s'expriment, l'une et l'autre, par des propositions, et que toute proposition, étant formée de mots qui symbolisent des concepts, est chose relative à la vie sociale et à l'intelligence humaine. Que je dise « le sol est humide » ou « le sol n'est pas humide », dans les deux cas les termes « sol » et « humide » sont des concepts plus ou moins artificiellement créés par l'esprit de l'homme, je veux dire extraits par sa libre initiative de la continuité de l'expérience. Dans les deux cas, ces concepts sont représentés par les mêmes mots conventionnels. Dans les deux cas on peut même dire, à la rigueur, que la proposition vise une fin sociale et pédagogique, puisque la première propagerait une vérité comme la seconde préviendrait une erreur. Si l'on se place à ce point de vue, qui est celui de la logique formelle, affirmer et nier sont bien en effet deux actes symétriques l'un de l'autre, dont le premier établit un rapport de convenance et le second un rapport de disconvenance entre un sujet et un attribut. - Mais comment ne pas voir que la symétrie est tout extérieure et la ressemblance superficielle ? Supposez aboli le langage, dissoute la société, atrophiée chez l'homme toute initiative intellectuelle, toute faculté de se dédoubler et de se juger lui-même : l'humidité du sol n'en subsistera pas moins, capable de s'inscrire automatiquement dans la sensation et d'envoyer une vague représentation à l'intelligence hébétée. L'intelligence affirmera donc encore, en termes implicites. Et, par conséquent, ni les concepts distincts, ni les mots, ni le désir de répandre la vérité autour de soi, ni celui de s'améliorer soi-même, n'étaient de l'essence même de l'affirmation. Mais cette intelligence passive, qui emboîte machinalement le pas de l'expérience, qui n'avance ni ne retarde sur le cours du réel, n'aurait aucune velléité de nier. Elle ne saurait recevoir une empreinte de négation, car, encore une fois, ce qui existe peut venir s'enregistrer, mais l'inexistence de l'inexistant ne s'enregistre pas. Pour qu'une pareille intelligence arrive à nier, il faudra qu'elle se réveille de sa torpeur, qu'elle formule la déception d'une attente réelle ou possible, qu'elle corrige une erreur actuelle ou éventuelle, enfin qu'elle se propose de faire la leçon aux autres ou à elle-même. On aura plus de peine à s'en apercevoir sur l'exemple que nous avons choisi, mais l'exemple n'en sera que plus instructif et l'argument plus probant. Si l'humidité est capable de venir s'enregistrer automatiquement, il en est de même, dira-t-on, de la non-humidité, car le sec peut, aussi bien que l'humide, donner des impressions à la sensibilité qui les transmettra comme des représentations plus ou moins distinctes à l'intelligence. En ce sens, la négation de l'humidité serait chose aussi objective, aussi purement intellectuelle, aussi détachée de toute intention pédagogique que l'affirmation. - Mais qu'on y regarde de près : on verra que la proposition négative « le sol n'est pas humide » et la proposition affirmative « le sol est sec » ont des contenus tout différents. La seconde implique que l'on connaît le sec, qu'on a éprouvé les sensations spécifiques, tactiles ou visuelles par exemple, qui sont à la base de cette représentation. La première n'exige rien de semblable : elle pourrait aussi bien être formulée par un poisson intelligent, qui n'aurait jamais perçu que de l'humide. Il faudrait, il est vrai, que ce poisson se fût élevé jusqu'à la distinction du réel et du possible, et qu'il se souciât d'aller au-devant de l'erreur de ses congénères, lesquels considèrent sans doute comme seules possibles les conditions d'humidité où ils vivent effectivement. Tenez-vous en strictement aux termes de la proposition « le soi n'est pas humide », vous trouverez qu'elle signifie deux choses : 1° qu'on pourrait croire que le sol est humide, 2° que l'humidité est remplacée en fait par une certaine qualité x . Cette qualité, on la laisse dans l'indétermination, soit qu'on n'en ait pas la connaissance positive, soit qu'elle n'ait aucun intérêt actuel pour la personne à laquelle la négation s'adresse. Nier consiste donc bien toujours à présenter sous une forme tronquée un système de deux affirmations, l'une déterminée qui porte sur un certain possible, l'autre indéterminée, se rapportant a la réalité inconnue ou indifférente qui supplante cette possibilité : la seconde affirmation est virtuellement contenue dans le jugement que nous portons sur la première, jugement qui est la négation même. Et ce qui donne à la négation son caractère subjectif, c'est précisément que, dans la constatation d'un remplacement, elle ne tient compte que du remplacé et ne s'occupe pas du remplaçant. Le remplacé n'existe que comme conception de l'esprit. Il faut, pour continuer à le voir et par conséquent pour en parler, tourner le dos à la réalité, qui coule du passé au présent, d'arrière en avant. C'est ce qu'on fait quand on nie. On constate le changement, ou plus généralement la substitution, comme verrait le trajet de la voiture un 'voyageur qui regarderait en arrière et ne voudrait connaître à chaque instant que le point où il a cessé d'être ; il ne déterminerait jamais sa position actuelle que par rapport à celle qu'il vient de quitter au lieu de l'exprimer en fonction d'elle-même. En résumé, pour un esprit qui suivrait purement et simplement le fil de l'expérience, il n'y aurait pas de vide, pas de néant, même relatif ou partiel, pas de négation possible. Un pareil esprit verrait des faits succéder à des faits, des états à des états, des choses à des choses. Ce qu'il noterait à tout moment, ce sont des choses qui existent, des états qui apparaissent, des faits qui se produisent. Il vivrait dans l'actuel et, s'il était capable de juger, il n'affirmerait jamais que l'existence du présent. Dotons cet esprit de mémoire et surtout du désir de s'appesantir sur le passé. Donnons-lui la faculté de dissocier et de distinguer. Il ne notera plus seulement l'état actuel de la réalité qui passe. Il se représentera le passage comme un changement, par conséquent comme un contraste entre ce qui a été et ce qui est. Et comme il n'y a pas de différence essentielle entre un passé qu'on se remémore et un passé qu'on imagine, il aura vite fait de s'élever à la représentation du possible en général. Il s'aiguillera ainsi sur la voie de la négation. Et sur. tout il sera sur le point de se représenter une disparition. Il n'y arrivera pourtant pas encore. Pour se représenter qu'une chose a disparu, il ne suffit pas d'apercevoir nu contraste entre le passé et le présent ; il faut encore tourner le dos au présent, s'appesantir sur le passé, et penser le contraste du passé avec le présent en termes de passé seulement, sans y faire figurer le présent. L'idée d'abolition n'est donc pas une pure idée ; elle implique qu'on regrette le passé ou qu'on le conçoit regrettable, qu'on a quelque raison de s'y attarder. Elle naît lorsque le phénomène de la substitution est coupé en deux par un esprit qui n'en considère que la première moitié, parce qu'il ne s'intéresse qu'à elle. Supprimez tout intérêt, toute affection : il ne reste plus que la réalité qui coule, et la connaissance indéfiniment renouvelée qu'elle imprime en nous de son état présent. De l'abolition à la négation, qui est une opération plus générale, il n'y a maintenant qu'un pas. Il suffit qu'on se représente le contraste de ce qui est, non seulement avec ce qui a été, mais encore avec tout ce qui aurait pu être. Et il faut qu'on exprime ce contraste en fonction de ce qui aurait pu être et non pas de ce qui est, qu'on affirme l'existence de l'actuel en ne regardant que le possible. La formule qu'on obtient ainsi n'exprime plus simplement une déception de l'individu : elle est faite pour corriger ou prévenir une erreur, qu'on suppose plutôt être l'erreur d'autrui. En ce sens, la négation a un caractère pédagogique et social. Maintenant, une fois la négation formulée, elle présente un aspect symétrique de celui de l'affirmation. Il nous semble alors que, si celle-ci affirmait une réalité objective, celle-là doit affirmer une non-réalité également objective et, pour ainsi dire, également réelle. En quoi nous avons à la fois tort et raison : tort, puisque la négation ne saurait s'objectiver dans ce qu'elle a de négatif; raison cependant, en ce que la négation d'une chose implique l'affirmation latente de son remplacement par une autre chose, qu'on laisse de côté systématiquement. Mais la forme négative de la négation bénéficie de l'affirmation qui est au fond d'elle : chevauchant sur le corps de réalité positive auquel il est attaché, ce fantôme s'objective. Ainsi se forme l'idée de vide ou de néant partiel, une chose se trouvant remplacée non plus par une autre chose, mais par un vide qu'elle laisse, c'est-à-dire par la négation d'elle-même. Comme d'ailleurs cette opération se pratique sur n'importe quelle chose, nous la supposons s'effectuant sur chaque chose tour à tour, et enfin effectuée sur toutes choses en bloc. Nous obtenons ainsi l'idée du « néant absolu». Que si maintenant nous analysons cette idée de Rien, nous trouvons qu'elle est, au fond, l'idée de Tout, avec, en plus, un mouvement de l'esprit qui saute indéfiniment d'une chose à une autre, refuse de se tenir en place, et concentre toute son attention sur ce refus en ne déterminant jamais sa position actuelle que par rapport à celle qu'il vient de quitter. C'est donc une représentation éminemment compréhensive et pleine, aussi pleine et compréhensive que l'idée de Tout, avec laquelle elle a la plus étroite parenté. Comment opposer alors l'idée de Rien à celle de Tout ? Ne voit-on pas que c'est opposer du plein à du plein, et que la question de savoir« pourquoi quelque chose existe» est par conséquent une question dépourvue de sens, un pseudo-problème soulevé autour d'une pseudo-idée ? Il faut pourtant que nous disions encore une fois pourquoi ce fantôme de problème hante l'esprit avec une telle obstination. En vain nous montrons que, dans la représentation d'une « abolition du réel », il n'y a que l'image de toutes réalités se chassant les unes les autres, indéfiniment, en cercle. En vain nous ajoutons que l'idée d'inexistence n'est que celle de l'expulsion d'une existence impondérable, ou existence « simplement possible », par une existence plus substantielle, qui serait la vraie réalité. En vain nous trouvons dans la forme sui generis de la négation quelque chose d'extra-intellectuel, la négation étant le jugement d'un jugement, un avertissement donné a autrui ou à soi-même, de sorte qu'il serait absurde de lui attribuer le pouvoir de créer des représentations d'un nouveau genre, des idées sans contenu. Toujours la conviction persiste qu'avant les choses, ou tout au moins sous les choses, il y a le néant. Si l'on cherche la raison de ce fait, on la trouve précisément dans l'élément affectif, social et, pour tout dire, pratique, qui donne sa forme spécifique à la négation. Les plus grosses difficultés philosophiques naissent, disions-nous, de ce que les formes de l'action humaine s'aventurent hors de leur domaine propre. Nous sommes faits pour agir autant et plus que pour penser ; - ou plutôt, quand nous suivons le mouvement de notre nature, c'est pour agir que nous pensons. Il ne faut donc pas s'étonner que les habitudes de l'action déteignent sur celles de la représentation, et que notre esprit aperçoive toujours les choses dans l'ordre même où nous avons coutume de nous les figurer quand nous nous proposons d'agir sur elles. Or il est incontestable, comme nous le faisions remarquer plus haut, que toute action humaine a son point de départ dans une dissatisfaction et, par là même, dans un sentiment d'absence. On n'agirait pas si l'on ne se proposait un but, et l'on ne recherche une chose que parce qu'on en ressent la privation. Notre action procède ainsi de « rien » à « quelque chose », et elle a pour essence même de broder « quelque chose » sur le canevas du « rien ». A vrai dire, le rien dont il est question ici n'est pas tant l'absence d'une chose que celle d'une utilité. Si je mène un visiteur dans une chambre que je n'ai pas encore garnie de meubles, je l'avertis « qu'il n'y a rien ». Je sais pourtant que la chambre est pleine d'air; mais, comme ce n'est pas sur de l'air qu'on s'assoit, la chambre ne contient véritablement rien de ce qui, en ce moment, pour le visiteur et pour moi-même, compte pour quelque chose. D'une manière générale, le travail humain consiste à créer de l'utilité ; et, tant que le travail n'est pas fait, il n'y a « rien », - rien de ce qu'on voulait obtenir. Notre vie se passe ainsi à combler des vides, que notre intelligence conçoit sous l'influence extra-intellectuelle du désir et du regret, sous la pression des nécessités vitales : et, si l'on entend par vide une absence d'utilité et non pas de choses, on peut dire, dans ce sens tout relatif, que nous allons constamment du vide au plein. Telle est la direction où marche notre action. Notre spéculation ne peut s'empêcher d'en faire autant, et, naturellement, elle passe du sens relatif au sens absolu, puisqu'elle s'exerce sur les choses mêmes et non pas sur l'utilité qu'elles ont pour nous. Ainsi s'implante en nous l'idée que la réalité comble un vide, et que le néant, conçu comme une absence de tout, préexiste à toutes choses en droit, sinon en fait. C'est cette illusion que nous avons essayé de dissiper, en montrant que l'idée de Rien, si l'on prétend y voir celle d'une abolition de toutes choses, est une idée destructive d'elle-même et se réduit à un simple mot, - que si, au contraire, c'est véritablement une idée, on y trouve autant de matière que dans l'idée de Tout. Cette longue analyse était nécessaire pour montrer qu'une réalité qui se suffit à elle-même n'est pas nécessairement une réalité étrangère à la durée. Si l'on passe (consciemment ou inconsciemment) par l'idée du néant pour arriver à celle de l'Être, l'Être auquel on aboutit est une essence logique ou mathématique, partant intemporelle. Et, dès lors, une conception statique du réel s'impose : tout paraît donné en une seule fois, dans l'éternité. Mais il faut s'habituer à penser l'Être directement, sans faire un détour, sans s'adresser d'abord au fantôme de néant qui s'interpose entre lui et nous. Il faut tâcher ici de voir pour voir, et non plus de voir pour agir. Alors l'Absolu se révèle très près de nous et, dans une certaine mesure, en nous. Il est d'essence psychologique, et non pas mathématique ou logique. Il vit avec nous. Comme nous, mais, par certains côtés, infiniment plus concentré et plus ramassé sur lui-même, il dure.
*L'analyse que nous donnons Ici de l'idée de néant (pp. 275 à 298) a déjà paru dans la Revue philosophique (novembre 1906). **Kant, Critique de la raison pure, 2e édit., p. 737 - - Au point de vue du contenu de notre connaissance en général, ... les propositions négatives ont pour fonction propre simplement d'empêcher l'erreur. - Cf.. Sigwart, Logik, 2e édit., vol. 1, p. 150 et suiv.
********************* ********************* |